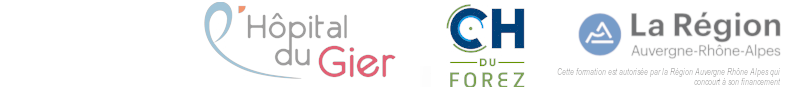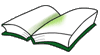[article]
| Titre : |
Autour du délire : dossier |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Armel Rivallan, Auteur ; Annick Perrin-Niquet, Auteur |
| Année de publication : |
2023 |
| Article en page(s) : |
pp. 9-38 |
| Langues : |
Français (fre) |
| Catégories : |
Anxiété ; Délire ; Ecoute ; HUMANISATION DES SOINS ; Littérature ; Psychanalyse ; Psychiatrie ; Souffrance ; Symptôme
|
| Résumé : |
Le mot délire est apparu dans la langue française au xv e siècle. Du latin delirium , dérivé de delirare , il signifie sortir du sillon, c’est-à -dire être en proie à la folie dès que l’on s’en écarte.
Le délire a toujours été présent chez l’humain puisqu’il est lié à la vie psychique et intellectuelle. Il est souvent apparenté à l’image de la folie qui a alimenté, et alimente encore, la littérature, le théâtre, le cinéma, etc.
Dans l’histoire de la psychiatrie, plusieurs grands personnages, tels Philippe Pinel
, Jean-Étienne Dominique Esquirol , Gaëtan Gatian de Clérambault et Henry Ey
, ont mis en lumière la problématique du délire, sa place et son sens dans l’expression de la folie ou des pathologies.
Le délire a été pendant des années le fleuron de l’enseignement infirmier en psychiatrie. Son type (systématisé ou non), ses mécanismes, ses thèmes, etc., étaient largement analysés. Cet enseignement était alimenté par des situations concrètes et de “jolies” petites histoires permettant d’identifier la souffrance, de la comprendre et de l’accompagner ; de mieux appréhender ce mode de relation au monde ; de l’envisager comme une réponse, une tentative de mise en sens, de guérison
, lorsque tout nous Ă©chappe.
Qu’en est-il aujourd’hui du délire dans les prises en charge des patients ? S’il existe toujours autant de sujets concernés, comment l’expression de cette souffrance est-elle accueillie ? Quelle place occupe le “délire” (pour ne pas parler de troubles délirants) dans les différentes formations des professionnels ?
Face à l’avancée des neurosciences , aux nouveaux concepts, comme le haut potentiel émotionnel, et au “tout bipolaire”, plus acceptable pour les patients et les familles lors de l’annonce du diagnostic, il paraît essentiel de rappeler la clinique multidimensionnelle du trouble délirant afin d’en conserver le sens.
En tant que signe et symptôme d’une pathologie mentale, le délire doit continuer à faire l’objet d’une attention particulière et de soins adaptés de la part des soignants afin d’accompagner les patients en souffrance à la recherche d’un bien-être ou d’un mieux-être acceptable. |
| Localisation OPAC : |
Montbrison/St-Chamond |
| Support (OPAC) : |
Article de revue / En ligne (Abo. IFSI) |
| En ligne : |
https://www.em-premium.com/revue/spsy |
in Soins psychiatrie > 348 (septembre 2023) . - pp. 9-38
[article] Autour du délire : dossier [texte imprimé] / Armel Rivallan, Auteur ; Annick Perrin-Niquet, Auteur . - 2023 . - pp. 9-38. Langues : Français ( fre) in Soins psychiatrie > 348 (septembre 2023) . - pp. 9-38
| Catégories : |
Anxiété ; Délire ; Ecoute ; HUMANISATION DES SOINS ; Littérature ; Psychanalyse ; Psychiatrie ; Souffrance ; Symptôme
|
| Résumé : |
Le mot délire est apparu dans la langue française au xv e siècle. Du latin delirium , dérivé de delirare , il signifie sortir du sillon, c’est-à -dire être en proie à la folie dès que l’on s’en écarte.
Le délire a toujours été présent chez l’humain puisqu’il est lié à la vie psychique et intellectuelle. Il est souvent apparenté à l’image de la folie qui a alimenté, et alimente encore, la littérature, le théâtre, le cinéma, etc.
Dans l’histoire de la psychiatrie, plusieurs grands personnages, tels Philippe Pinel
, Jean-Étienne Dominique Esquirol , Gaëtan Gatian de Clérambault et Henry Ey
, ont mis en lumière la problématique du délire, sa place et son sens dans l’expression de la folie ou des pathologies.
Le délire a été pendant des années le fleuron de l’enseignement infirmier en psychiatrie. Son type (systématisé ou non), ses mécanismes, ses thèmes, etc., étaient largement analysés. Cet enseignement était alimenté par des situations concrètes et de “jolies” petites histoires permettant d’identifier la souffrance, de la comprendre et de l’accompagner ; de mieux appréhender ce mode de relation au monde ; de l’envisager comme une réponse, une tentative de mise en sens, de guérison
, lorsque tout nous Ă©chappe.
Qu’en est-il aujourd’hui du délire dans les prises en charge des patients ? S’il existe toujours autant de sujets concernés, comment l’expression de cette souffrance est-elle accueillie ? Quelle place occupe le “délire” (pour ne pas parler de troubles délirants) dans les différentes formations des professionnels ?
Face à l’avancée des neurosciences , aux nouveaux concepts, comme le haut potentiel émotionnel, et au “tout bipolaire”, plus acceptable pour les patients et les familles lors de l’annonce du diagnostic, il paraît essentiel de rappeler la clinique multidimensionnelle du trouble délirant afin d’en conserver le sens.
En tant que signe et symptôme d’une pathologie mentale, le délire doit continuer à faire l’objet d’une attention particulière et de soins adaptés de la part des soignants afin d’accompagner les patients en souffrance à la recherche d’un bien-être ou d’un mieux-être acceptable. |
| Localisation OPAC : |
Montbrison/St-Chamond |
| Support (OPAC) : |
Article de revue / En ligne (Abo. IFSI) |
| En ligne : |
https://www.em-premium.com/revue/spsy |
|  |
 Accueil
Accueil