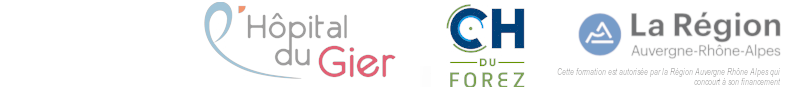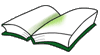[article]
| Titre : |
Histoire de consentement : Dossier |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Anne JOCHEM, Auteur ; Annick Perrin-Niquet, Auteur |
| Année de publication : |
2021 |
| Article en page(s) : |
pp. 11-34 |
| Catégories : |
Adolescent ; Alliance thérapeutique ; Anorexie mentale ; Autonomie ; CATTP ; Consentement ; Droit ; Equipe soins ; Ethique ; Famille ; Information ; Liberté individuelle ; Psychopathologie ; Refus soins ; Relation soignant soigné ; Santé mentale ; Schizophrénie ; Sémiologie ; Travail pluridisciplinaire ; Trouble comportement alimentaire ; Vulnérabilité
|
| Résumé : |
La crise sanitaire provoque en nous des sentiments contradictoires, nous passons de la résistance à la soumission, éprouvant de la lassitude, du découragement, de la peur ou de l’espoir par des réponses vaccinales. Toutes ces émotions qui traversent nos vies aujourd’hui sont un reflet de nos représentations de la maladie. Ces représentations, qui ne recueillent pas facilement notre acquiescement, nous amènent à questionner l’engagement du soin, l’accompagnement et, en fin de compte, le sens du consentement. Comment le recueillir ? Comment le patient, en proie aux perturbations cliniques, peut-il s’exprimer ? Le consentement des personnes fragiles, vulnérables souffrant de troubles psychiques demande une attention particulière ; son recueil par les professionnels est une démarche délicate qui fait appel à de multiples capacités d’écoute, d’analyse, d’évaluation et d’habileté relationnelle. Consentir à des soins de psychiatrie nécessite de se reconnaître malade. Or, des mécanismes de défense tels le déni, la dénégation, mais aussi des sentiments comme l’autostigmatisation, la culpabilité, la honte, viennent recouvrir l’effraction psychique que représente la maladie. Les proches s’inquiètent, se renseignent, tentent de convaincre la personne concernée de rencontrer un professionnel de santé. Tentatives souvent mises en échec et sources de tensions et de conflits. Consentir nécessite la préservation de la capacité cognitive de discernement, véritable levier de l’accès aux soins. Revenir vers le patient jusqu’à ce que le consentement soit donné ou bien initier le soin dans l’attente du consentement dans la logique de l’équation bénéfice-risque, voilà à quoi s’attellent non seulement le médecin mais aussi l’ensemble de l’équipe de soins. Revenir vers le patient au fil de la prise en charge permet également de solliciter l’insight du patient pour recueillir son accord, son avis sur les soins reçus ou à venir, manière bien concrète de le placer au centre de son projet de soins et de soutenir son pouvoir d’agir et d’autodétermination. Ce faisant, les professionnels se doivent de faire évoluer la relation de soin et s’aguerrir à l’art de la négociation. |
| Localisation OPAC : |
Montbrison/St-Chamond |
| Support (OPAC) : |
Article de revue / En ligne (Abo. IFSI) |
| En ligne : |
https://www.em-premium.com/article/doi/10.1016/j.spsy.2021.03.002 |
in Soins psychiatrie > 333 (mars 2021) . - pp. 11-34
[article] Histoire de consentement : Dossier [texte imprimé] / Anne JOCHEM, Auteur ; Annick Perrin-Niquet, Auteur . - 2021 . - pp. 11-34. in Soins psychiatrie > 333 (mars 2021) . - pp. 11-34
| Catégories : |
Adolescent ; Alliance thérapeutique ; Anorexie mentale ; Autonomie ; CATTP ; Consentement ; Droit ; Equipe soins ; Ethique ; Famille ; Information ; Liberté individuelle ; Psychopathologie ; Refus soins ; Relation soignant soigné ; Santé mentale ; Schizophrénie ; Sémiologie ; Travail pluridisciplinaire ; Trouble comportement alimentaire ; Vulnérabilité
|
| Résumé : |
La crise sanitaire provoque en nous des sentiments contradictoires, nous passons de la résistance à la soumission, éprouvant de la lassitude, du découragement, de la peur ou de l’espoir par des réponses vaccinales. Toutes ces émotions qui traversent nos vies aujourd’hui sont un reflet de nos représentations de la maladie. Ces représentations, qui ne recueillent pas facilement notre acquiescement, nous amènent à questionner l’engagement du soin, l’accompagnement et, en fin de compte, le sens du consentement. Comment le recueillir ? Comment le patient, en proie aux perturbations cliniques, peut-il s’exprimer ? Le consentement des personnes fragiles, vulnérables souffrant de troubles psychiques demande une attention particulière ; son recueil par les professionnels est une démarche délicate qui fait appel à de multiples capacités d’écoute, d’analyse, d’évaluation et d’habileté relationnelle. Consentir à des soins de psychiatrie nécessite de se reconnaître malade. Or, des mécanismes de défense tels le déni, la dénégation, mais aussi des sentiments comme l’autostigmatisation, la culpabilité, la honte, viennent recouvrir l’effraction psychique que représente la maladie. Les proches s’inquiètent, se renseignent, tentent de convaincre la personne concernée de rencontrer un professionnel de santé. Tentatives souvent mises en échec et sources de tensions et de conflits. Consentir nécessite la préservation de la capacité cognitive de discernement, véritable levier de l’accès aux soins. Revenir vers le patient jusqu’à ce que le consentement soit donné ou bien initier le soin dans l’attente du consentement dans la logique de l’équation bénéfice-risque, voilà à quoi s’attellent non seulement le médecin mais aussi l’ensemble de l’équipe de soins. Revenir vers le patient au fil de la prise en charge permet également de solliciter l’insight du patient pour recueillir son accord, son avis sur les soins reçus ou à venir, manière bien concrète de le placer au centre de son projet de soins et de soutenir son pouvoir d’agir et d’autodétermination. Ce faisant, les professionnels se doivent de faire évoluer la relation de soin et s’aguerrir à l’art de la négociation. |
| Localisation OPAC : |
Montbrison/St-Chamond |
| Support (OPAC) : |
Article de revue / En ligne (Abo. IFSI) |
| En ligne : |
https://www.em-premium.com/article/doi/10.1016/j.spsy.2021.03.002 |
|  |
 Accueil
Accueil