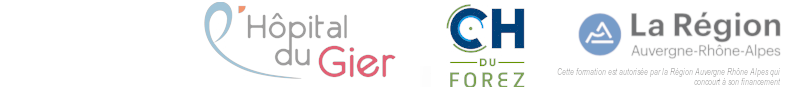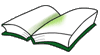Catalogue des IFSI - IFAS de Saint-Chamond et de Montbrison (Loire - 42)
 Accueil
Accueil
|
Exemplaires(1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| MON0000004036 | Revues | Revue - [m] | CDTI Montbrison | Revues | Disponible |
DĂ©pouillements

 Ajouter le résultat dans votre panier
Ajouter le résultat dans votre panier
Titre : Covid-19 : une équipe d’hygiène hospitalière au cœur du dispositif de crise Type de document : texte imprimé Auteurs : Benoît HUC, Auteur ; Marie-Laurence BERNET, Auteur ; Isabelle CANDALOT, Auteur ; et al. Année de publication : 2020 Article en page(s) : pp. 213-215 Catégories : Communication ; Dépistage ; Epidémie ; Equipement ; Formation ; Gestion ; Hygiène hospitalière ; Prévention maladie transmissible ; Protection individuelle ; Protection sanitaire population Résumé : Au moment où nous écrivons ces lignes, fin juin2020, la commission d’enquête parlementaire auditionne de nombreux dirigeants et experts pour tenter d’analyser les défaillances dans la «gestion de la crise». Un des points positifs, que beau-coup ont fait ressortir, concerne les «établissements de santé» qui ont su se mobiliser et se réorganiser rapide-ment pour faire face à cette crise inédite. Le centre hospitalier (CH) d’Oloron-Sainte-Marie, comme tant d’autres très certainement, s’appuyant sur toutes ses ressources médicosoignantes, logistiques et administratives, s’est mobilisé sans relâche pour s’adapter au mieux à l’arrivée des patients potentiellement atteints de Covid-19, tout en tenant compte des nombreuses recommandations du ministère de la Santé, des agences régionales de santé (ARS) et du Haut Conseil de la santé publique. Localisation OPAC : Montbrison/St-Chamond Support (OPAC) : Article de revue / En ligne (Abo. IFSI)
in Hygiènes > 28 (4) (septembre 2020) . - pp. 213-215[article] Covid-19 : une équipe d’hygiène hospitalière au cœur du dispositif de crise [texte imprimé] / Benoît HUC, Auteur ; Marie-Laurence BERNET, Auteur ; Isabelle CANDALOT, Auteur ; et al. . - 2020 . - pp. 213-215.
in Hygiènes > 28 (4) (septembre 2020) . - pp. 213-215
Catégories : Communication ; Dépistage ; Epidémie ; Equipement ; Formation ; Gestion ; Hygiène hospitalière ; Prévention maladie transmissible ; Protection individuelle ; Protection sanitaire population Résumé : Au moment où nous écrivons ces lignes, fin juin2020, la commission d’enquête parlementaire auditionne de nombreux dirigeants et experts pour tenter d’analyser les défaillances dans la «gestion de la crise». Un des points positifs, que beau-coup ont fait ressortir, concerne les «établissements de santé» qui ont su se mobiliser et se réorganiser rapide-ment pour faire face à cette crise inédite. Le centre hospitalier (CH) d’Oloron-Sainte-Marie, comme tant d’autres très certainement, s’appuyant sur toutes ses ressources médicosoignantes, logistiques et administratives, s’est mobilisé sans relâche pour s’adapter au mieux à l’arrivée des patients potentiellement atteints de Covid-19, tout en tenant compte des nombreuses recommandations du ministère de la Santé, des agences régionales de santé (ARS) et du Haut Conseil de la santé publique. Localisation OPAC : Montbrison/St-Chamond Support (OPAC) : Article de revue / En ligne (Abo. IFSI) Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MON0000004036 Revues Revue - [m] CDTI Montbrison Revues Disponible Escherichia coli producteur de bêtalactamases à spectre étendu et précautions standard / Killian LE NEINDRE in Hygiènes, 28 (4) (septembre 2020)
Titre : Escherichia coli producteur de bêtalactamases à spectre étendu et précautions standard : bilan après trois ans au centre hospitalier universitaire de Rennes Type de document : texte imprimé Auteurs : Killian LE NEINDRE, Auteur ; Amélie MORIN-LE BIHAN, Auteur ; Guillaume MÉNARD, Auteur ; et al. Année de publication : 2020 Article en page(s) : pp. 201-206 Catégories : Contagion ; Enquête épidémiologique ; Escherichia coli ; Etude prospective ; Exposition ; Hospitalisation ; Infection nosocomiale ; Méthodologie ; Patient ; Prévention primaire ; Prise charge Résumé : Objectif. Évaluer l’importance de la transmission croisée d’Escherichia coliproducteur de bêtalactamases à spectre étendu (ECBLSE) au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes depuis l’arrêt en 2015 de la mise en place de précautions complémentaires contact pour les patients porteurs. Méthode. Une étude rétrospective de janvier2015 à octobre2018 a été réalisée au CHU. Une extraction informatique de tout prélèvement, diagnostique ou de dépistage, positif à ECBLSE pour les patients hospitalisés a été effectuée. L’analyse a suivi 3 étapes: (1) sélection des isolats provenant d’au moins deux patients du même service à 20 jours d’intervalle maximum, ayant le même profil d’antibiogramme et une notion d’acquisition hospitalière pour l’un des patients, (2) comparaison des profils de sensibilité des isolats sélectionnés par la méthode de la distance euclidienne, (3) étude des dossiers des patients retenus. Les critères sont un chevauchement des séjours de 2 patients porteurs avec une notion d’acquisition au sein de l’établissement. Résultats. Au total, 730 patients ont été inclus dont 334 (45,8%) avaient au moins un isolat prélevé dans les deux premiers jours d’hospitalisation. Après application des deux premières étapes, les 63 dossiers restants ont permis d’identifier 20 patients (2,7%) susceptibles d’être impliqués dans un évènement de transmission croisée dont 11 en médecine, chirurgie, obstétrique hors réanimation (2,1%), 4 en réanimation (1,6%), 3 en soins de suite et de réadaptation (33,3%) et 2 en soins de longue durée (8%). Conclusion. Nos résultats sont cohérents avec ceux de la littérature. Ce bilan est en faveur de l’arrêt de l’application des précautions complémentaires contact pour les patients porteurs d’ECBLSE. Localisation OPAC : Montbrison/St-Chamond Support (OPAC) : Article de revue / En ligne (Abo. IFSI)
in Hygiènes > 28 (4) (septembre 2020) . - pp. 201-206[article] Escherichia coli producteur de bêtalactamases à spectre étendu et précautions standard : bilan après trois ans au centre hospitalier universitaire de Rennes [texte imprimé] / Killian LE NEINDRE, Auteur ; Amélie MORIN-LE BIHAN, Auteur ; Guillaume MÉNARD, Auteur ; et al. . - 2020 . - pp. 201-206.
in Hygiènes > 28 (4) (septembre 2020) . - pp. 201-206
Catégories : Contagion ; Enquête épidémiologique ; Escherichia coli ; Etude prospective ; Exposition ; Hospitalisation ; Infection nosocomiale ; Méthodologie ; Patient ; Prévention primaire ; Prise charge Résumé : Objectif. Évaluer l’importance de la transmission croisée d’Escherichia coliproducteur de bêtalactamases à spectre étendu (ECBLSE) au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes depuis l’arrêt en 2015 de la mise en place de précautions complémentaires contact pour les patients porteurs. Méthode. Une étude rétrospective de janvier2015 à octobre2018 a été réalisée au CHU. Une extraction informatique de tout prélèvement, diagnostique ou de dépistage, positif à ECBLSE pour les patients hospitalisés a été effectuée. L’analyse a suivi 3 étapes: (1) sélection des isolats provenant d’au moins deux patients du même service à 20 jours d’intervalle maximum, ayant le même profil d’antibiogramme et une notion d’acquisition hospitalière pour l’un des patients, (2) comparaison des profils de sensibilité des isolats sélectionnés par la méthode de la distance euclidienne, (3) étude des dossiers des patients retenus. Les critères sont un chevauchement des séjours de 2 patients porteurs avec une notion d’acquisition au sein de l’établissement. Résultats. Au total, 730 patients ont été inclus dont 334 (45,8%) avaient au moins un isolat prélevé dans les deux premiers jours d’hospitalisation. Après application des deux premières étapes, les 63 dossiers restants ont permis d’identifier 20 patients (2,7%) susceptibles d’être impliqués dans un évènement de transmission croisée dont 11 en médecine, chirurgie, obstétrique hors réanimation (2,1%), 4 en réanimation (1,6%), 3 en soins de suite et de réadaptation (33,3%) et 2 en soins de longue durée (8%). Conclusion. Nos résultats sont cohérents avec ceux de la littérature. Ce bilan est en faveur de l’arrêt de l’application des précautions complémentaires contact pour les patients porteurs d’ECBLSE. Localisation OPAC : Montbrison/St-Chamond Support (OPAC) : Article de revue / En ligne (Abo. IFSI) Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MON0000004036 Revues Revue - [m] CDTI Montbrison Revues Disponible Filtres au point d’usage pour la prévention des infections associées aux soins d’origine hydrique / Philippe Hartemann in Hygiènes, 28 (4) (septembre 2020)
Titre : Filtres au point d’usage pour la prévention des infections associées aux soins d’origine hydrique : efficacité et évolutiondes connaissances Type de document : texte imprimé Auteurs : Philippe Hartemann, Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : pp. 187-191 Catégories : Analyse eau ; Bactériologie ; Contrôle qualité ; Epuration eau ; Etude prospective ; Filtration eau ; Hôpital ; Maladie légionnaire ; Prévention maladie transmissible ; Recommandation Résumé : Le guide technique L’Eau dans les établissements de santé publié en France en 2005 a introduit le concept d’eau bactériologiquement maîtrisée parmi diverses mesures destinées à prévenir le risque d’infection associée aux soins d’origine hydrique. Parmi les méthodes susceptibles d’obtenir ce type d’eau exempte de germes pathogènes opportunistes, la filtration est la plus communément répandue, en particulier par microfiltres dits terminaux au point d’usage. Ces filtres d’une porosité de 0,2 μm font l’objet de tests normatifs pour leur qualification et ont progressivement vu leur durée de vie s’allonger pour un usage unique. Cet article rappelle les justificatifs techniques de la filtration et présente les résultats des études techniques et cliniques récentes qui ont permis son emploi de plus en plus large et l’évolution probable des recommandations d’usage et des tests pour la qualification des filtres. Localisation OPAC : Montbrison/St-Chamond Support (OPAC) : Article de revue / En ligne (Abo. IFSI)
in Hygiènes > 28 (4) (septembre 2020) . - pp. 187-191[article] Filtres au point d’usage pour la prévention des infections associées aux soins d’origine hydrique : efficacité et évolutiondes connaissances [texte imprimé] / Philippe Hartemann, Auteur . - 2020 . - pp. 187-191.
in Hygiènes > 28 (4) (septembre 2020) . - pp. 187-191
Catégories : Analyse eau ; Bactériologie ; Contrôle qualité ; Epuration eau ; Etude prospective ; Filtration eau ; Hôpital ; Maladie légionnaire ; Prévention maladie transmissible ; Recommandation Résumé : Le guide technique L’Eau dans les établissements de santé publié en France en 2005 a introduit le concept d’eau bactériologiquement maîtrisée parmi diverses mesures destinées à prévenir le risque d’infection associée aux soins d’origine hydrique. Parmi les méthodes susceptibles d’obtenir ce type d’eau exempte de germes pathogènes opportunistes, la filtration est la plus communément répandue, en particulier par microfiltres dits terminaux au point d’usage. Ces filtres d’une porosité de 0,2 μm font l’objet de tests normatifs pour leur qualification et ont progressivement vu leur durée de vie s’allonger pour un usage unique. Cet article rappelle les justificatifs techniques de la filtration et présente les résultats des études techniques et cliniques récentes qui ont permis son emploi de plus en plus large et l’évolution probable des recommandations d’usage et des tests pour la qualification des filtres. Localisation OPAC : Montbrison/St-Chamond Support (OPAC) : Article de revue / En ligne (Abo. IFSI) Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MON0000004036 Revues Revue - [m] CDTI Montbrison Revues Disponible Fréquence du portage digestif de bactéries multirésistantes aux antibiotiques chez les patients contacts de patients porteurs de bactéries hautement résistantes émergentes au centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne / Philippe Berthelot in Hygiènes, 28 (4) (septembre 2020)
Titre : Fréquence du portage digestif de bactéries multirésistantes aux antibiotiques chez les patients contacts de patients porteurs de bactéries hautement résistantes émergentes au centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne Type de document : texte imprimé Auteurs : Philippe Berthelot, Auteur ; Yapo THOMAS ABA, Auteur ; Julie GAGNAIRE, Auteur ; et al. Année de publication : 2020 Article en page(s) : pp. 195-200 Catégories : Bactérie ; Contagion ; Dépistage ; Enquête qualitative ; Hospitalisation ; Laboratoire ; Lavage mains ; Médicament antibiotique ; Méthode quantitative ; Patient ; Prélèvement ; Recueil données Résumé : Introduction. Afin de maîtriser l’émergence des bactéries multi-résistantes (BMR) et des bactéries hautement résistantes émergentes (BHRe), le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Étienne dispose d’un recueil exhaustif des BHRe depuis 2010 et d’une surveillance des BMR à travers plusieurs systèmes informatiques. Notre étude visait à estimer la fréquence de portage digestif des BMR chez les patients contacts de patients porteurs de BHRe de janvier2013 à juin2016 avant et après dépistage rectal, en dehors d’un contexte d’épidémie de BHRe. Méthodes.Étude rétrospective d’une cohorte de patients contacts de patients hospitalisés porteurs de BHRe sporadiques. Les prélèvements de dépistage de BHRe étaient ensemencés sur des milieux sélectifs permettant de dépister les BMR avec réalisation systématique d’un antibiogramme. Ont été compilées les données sur les BMR issues de l’outil ConsoRes, du système de gestion du laboratoire de microbiologie et de la base Excel® des patients contacts de BHRe de janvier2013 à juin2016. Résultats. Sur 3000 patients contacts de patients porteurs de BHRe, 489 (16,3%) avaient des BMR dans des prélèvements à visée diagnostique ou de dépistage. Le portage digestif de BMR était relevé chez 342 patients contacts de BHRe (11,4%). Avant d’être identifiés patients contacts de BHRe, 3,4% (n=101) des patients contacts étaient déjà porteurs de BMR au niveau digestif. Après les écouvillonnages rectaux réalisés pour leur suivi réglementaire, 9,7% (n=292) des patients contacts ont été identifiés comme porteurs de BMR au niveau digestif. La proportion de détection de nouveau portage digestif de BMR après le contact était de 8,7% (n=260). Conclusion. Le dépistage réglementaire des patients porteurs de BHRe a permis de tripler la détection de portage digestif de BMR chez les patients contacts. Ces résultats témoignent de la sous-estimation du portage de BMR à l’hôpital et justifient l’application rigoureuse des précautions standard pour tous les patients des établissements de santé et la nécessité d’un juste usage de l’antibiothérapie. Localisation OPAC : Montbrison/St-Chamond Support (OPAC) : Article de revue / En ligne (Abo. IFSI)
in Hygiènes > 28 (4) (septembre 2020) . - pp. 195-200[article] Fréquence du portage digestif de bactéries multirésistantes aux antibiotiques chez les patients contacts de patients porteurs de bactéries hautement résistantes émergentes au centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne [texte imprimé] / Philippe Berthelot, Auteur ; Yapo THOMAS ABA, Auteur ; Julie GAGNAIRE, Auteur ; et al. . - 2020 . - pp. 195-200.
in Hygiènes > 28 (4) (septembre 2020) . - pp. 195-200
Catégories : Bactérie ; Contagion ; Dépistage ; Enquête qualitative ; Hospitalisation ; Laboratoire ; Lavage mains ; Médicament antibiotique ; Méthode quantitative ; Patient ; Prélèvement ; Recueil données Résumé : Introduction. Afin de maîtriser l’émergence des bactéries multi-résistantes (BMR) et des bactéries hautement résistantes émergentes (BHRe), le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Étienne dispose d’un recueil exhaustif des BHRe depuis 2010 et d’une surveillance des BMR à travers plusieurs systèmes informatiques. Notre étude visait à estimer la fréquence de portage digestif des BMR chez les patients contacts de patients porteurs de BHRe de janvier2013 à juin2016 avant et après dépistage rectal, en dehors d’un contexte d’épidémie de BHRe. Méthodes.Étude rétrospective d’une cohorte de patients contacts de patients hospitalisés porteurs de BHRe sporadiques. Les prélèvements de dépistage de BHRe étaient ensemencés sur des milieux sélectifs permettant de dépister les BMR avec réalisation systématique d’un antibiogramme. Ont été compilées les données sur les BMR issues de l’outil ConsoRes, du système de gestion du laboratoire de microbiologie et de la base Excel® des patients contacts de BHRe de janvier2013 à juin2016. Résultats. Sur 3000 patients contacts de patients porteurs de BHRe, 489 (16,3%) avaient des BMR dans des prélèvements à visée diagnostique ou de dépistage. Le portage digestif de BMR était relevé chez 342 patients contacts de BHRe (11,4%). Avant d’être identifiés patients contacts de BHRe, 3,4% (n=101) des patients contacts étaient déjà porteurs de BMR au niveau digestif. Après les écouvillonnages rectaux réalisés pour leur suivi réglementaire, 9,7% (n=292) des patients contacts ont été identifiés comme porteurs de BMR au niveau digestif. La proportion de détection de nouveau portage digestif de BMR après le contact était de 8,7% (n=260). Conclusion. Le dépistage réglementaire des patients porteurs de BHRe a permis de tripler la détection de portage digestif de BMR chez les patients contacts. Ces résultats témoignent de la sous-estimation du portage de BMR à l’hôpital et justifient l’application rigoureuse des précautions standard pour tous les patients des établissements de santé et la nécessité d’un juste usage de l’antibiothérapie. Localisation OPAC : Montbrison/St-Chamond Support (OPAC) : Article de revue / En ligne (Abo. IFSI) Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MON0000004036 Revues Revue - [m] CDTI Montbrison Revues Disponible L’eau ozonée, une alternative à la désinfection des mains par un produit hydro-alcoolique ? / Joseph Hajjar in Hygiènes, 28 (4) (septembre 2020)
Titre : L’eau ozonée, une alternative à la désinfection des mains par un produit hydro-alcoolique ? Type de document : texte imprimé Auteurs : Joseph Hajjar, Auteur ; Olivia Keita-Perse, Auteur ; Philippe VANHEMS, Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : pp.231-234 Catégories : Désinfection ; Efficacité ; Etude faisabilité ; Hygiène hospitalière ; Lavage mains ; Méthodologie ; Microbiologie ; OMS ; Ozone ; Peau [pathologie] ; Recommandation Résumé : Depuis Semmelweis, l’hygiène des mains est la mesure incontournable pour empêcher la transmission des agents pathogènes. Dès les années 2000, la friction des mains par un produit hydro-alcoolique est la méthode de référence dans les établissements de santé en raison de son efficacité, de la simplicité de sa réalisation et d’une meilleure tolérance. Elle remplace le lavage des mains, fréquemment associé à une dermatite de contact irritante professionnelle (DCI) qui peut réduire l’observance de l’hygiène des mains [1,2]. Cependant, les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de 2009 et les programmes nationaux en lien avec ces recommandations ont montré que le large développement de la désinfection des mains par friction a été associé à des problèmes d’intolérance [3]. Ces intolérances peuvent être en rapport avec un accompagnement de terrain insuffisant, des erreurs dans le choix des produits et l’utilisation, telles que l’association de lavage et de friction, ou le port de gants sur des mains encore humides [4]. Elles sont à différencier des dermatites allergiques de contact (DAC) à l’alcool (isopropanol et éthanol) décrites dans quelques études [5].
L’intérêt des auteurs pour cette étude sur l’eau ozonée comme alternative pour l’hygiène des mains fait suite à la situation de deux chirurgiens ophtalmologistes ayant développé une dermatite des mains les conduisant à arrêter d’opérer ; leurs problèmes de peau ont été résolus après autorisation d’utiliser l’eau du robinet ozonée pour leur hygiène des mains avant un acte chirurgical. Au cours de la même période, la ville de Bergen (Norvège) a été confrontée à un foyer d’infection à Giardia lamblia de l’eau domestique, et les garderies pour enfants ont été invitées à utiliser l’eau du robinet ozonée pour l’hygiène des mains des enfants, sur la base d’une capacité de l’ozone à éradiquer les protozoaires [6].Localisation OPAC : Montbrison/St-Chamond Support (OPAC) : Article de revue / En ligne (Abo. IFSI)
in Hygiènes > 28 (4) (septembre 2020) . - pp.231-234[article] L’eau ozonée, une alternative à la désinfection des mains par un produit hydro-alcoolique ? [texte imprimé] / Joseph Hajjar, Auteur ; Olivia Keita-Perse, Auteur ; Philippe VANHEMS, Auteur . - 2020 . - pp.231-234.
in Hygiènes > 28 (4) (septembre 2020) . - pp.231-234
Catégories : Désinfection ; Efficacité ; Etude faisabilité ; Hygiène hospitalière ; Lavage mains ; Méthodologie ; Microbiologie ; OMS ; Ozone ; Peau [pathologie] ; Recommandation Résumé : Depuis Semmelweis, l’hygiène des mains est la mesure incontournable pour empêcher la transmission des agents pathogènes. Dès les années 2000, la friction des mains par un produit hydro-alcoolique est la méthode de référence dans les établissements de santé en raison de son efficacité, de la simplicité de sa réalisation et d’une meilleure tolérance. Elle remplace le lavage des mains, fréquemment associé à une dermatite de contact irritante professionnelle (DCI) qui peut réduire l’observance de l’hygiène des mains [1,2]. Cependant, les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de 2009 et les programmes nationaux en lien avec ces recommandations ont montré que le large développement de la désinfection des mains par friction a été associé à des problèmes d’intolérance [3]. Ces intolérances peuvent être en rapport avec un accompagnement de terrain insuffisant, des erreurs dans le choix des produits et l’utilisation, telles que l’association de lavage et de friction, ou le port de gants sur des mains encore humides [4]. Elles sont à différencier des dermatites allergiques de contact (DAC) à l’alcool (isopropanol et éthanol) décrites dans quelques études [5].
L’intérêt des auteurs pour cette étude sur l’eau ozonée comme alternative pour l’hygiène des mains fait suite à la situation de deux chirurgiens ophtalmologistes ayant développé une dermatite des mains les conduisant à arrêter d’opérer ; leurs problèmes de peau ont été résolus après autorisation d’utiliser l’eau du robinet ozonée pour leur hygiène des mains avant un acte chirurgical. Au cours de la même période, la ville de Bergen (Norvège) a été confrontée à un foyer d’infection à Giardia lamblia de l’eau domestique, et les garderies pour enfants ont été invitées à utiliser l’eau du robinet ozonée pour l’hygiène des mains des enfants, sur la base d’une capacité de l’ozone à éradiquer les protozoaires [6].Localisation OPAC : Montbrison/St-Chamond Support (OPAC) : Article de revue / En ligne (Abo. IFSI) Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MON0000004036 Revues Revue - [m] CDTI Montbrison Revues Disponible Le centre d’appui pour la prévention des infections associées aux soins de Bretagne pendant la crise de la Covid-19 / Mélissa MARTIN in Hygiènes, 28 (4) (septembre 2020)
Titre : Le centre d’appui pour la prévention des infections associées aux soins de Bretagne pendant la crise de la Covid-19 : des demandes inhabituelles Type de document : texte imprimé Auteurs : Mélissa MARTIN, Auteur ; Margaux CHARTIER, Auteur ; Killian LE NEINDRE, Auteur ; et al. Année de publication : 2020 Article en page(s) : pp. 217-220 Catégories : EHPAD ; Epidémie ; Equipement ; Etablissement médico social ; Hôpital ; Pratique professionnelle ; Prévention maladie transmissible ; Profession santé ; Protection individuelle ; Surveillance épidémiologique Résumé : Introduction. Pendant la crise sanitaire liée au SARS-CoV-2, le centre d’appui pour la prévention des infections associées aux soins (CPias) de Bretagne a été très sollicité. L’objectif était d’ana-lyser les thèmes des sollicitations et le profil des demandeurs entre le 1erfévrier et le 15juin 2020. Méthode. Nous avons ana-lysé qualitativement les thèmes des demandes, issues de notre outil de traçabilité commun. Résultats. Durant la période analysée, le CPias a répondu à 1034 sollicitations sur le thème «Covid-19», soit 95,2% de l’activité, contre 640 demandes tous thèmes confondus en 2019. Les profils des demandeurs sont inversés par rapport à 2019 avec plus de structures médico-sociales (54,9%) et plus de personnels non-soignants (25,9%), notamment des directeurs de structures. Sont principalement abordés les équipements de protection individuelle (30,2%) et l’environnement et l’entretien des locaux (24%). La conduite à tenir face à des cas suspects, positifs ou contacts a posé question, de même que la pathologie (contagiosité et organisation d’unités dédiées). Enfin, d’autres thèmes ont été abordés comme l’organisation (flux internes, consultations) et les visites des proches. Conclusion. Le CPias Bretagne a été très investi dans ses missions régionales de prévention et de contrôle de l’infection pendant cette crise sanitaire. De nombreux acteurs de la santé avaient besoin d’une adaptation ou d’une interprétation pratique des doctrines nationales, et d’avoir confirmation des conduites à tenir. Localisation OPAC : Montbrison/St-Chamond Support (OPAC) : Article de revue / En ligne (Abo. IFSI)
in Hygiènes > 28 (4) (septembre 2020) . - pp. 217-220[article] Le centre d’appui pour la prévention des infections associées aux soins de Bretagne pendant la crise de la Covid-19 : des demandes inhabituelles [texte imprimé] / Mélissa MARTIN, Auteur ; Margaux CHARTIER, Auteur ; Killian LE NEINDRE, Auteur ; et al. . - 2020 . - pp. 217-220.
in Hygiènes > 28 (4) (septembre 2020) . - pp. 217-220
Catégories : EHPAD ; Epidémie ; Equipement ; Etablissement médico social ; Hôpital ; Pratique professionnelle ; Prévention maladie transmissible ; Profession santé ; Protection individuelle ; Surveillance épidémiologique Résumé : Introduction. Pendant la crise sanitaire liée au SARS-CoV-2, le centre d’appui pour la prévention des infections associées aux soins (CPias) de Bretagne a été très sollicité. L’objectif était d’ana-lyser les thèmes des sollicitations et le profil des demandeurs entre le 1erfévrier et le 15juin 2020. Méthode. Nous avons ana-lysé qualitativement les thèmes des demandes, issues de notre outil de traçabilité commun. Résultats. Durant la période analysée, le CPias a répondu à 1034 sollicitations sur le thème «Covid-19», soit 95,2% de l’activité, contre 640 demandes tous thèmes confondus en 2019. Les profils des demandeurs sont inversés par rapport à 2019 avec plus de structures médico-sociales (54,9%) et plus de personnels non-soignants (25,9%), notamment des directeurs de structures. Sont principalement abordés les équipements de protection individuelle (30,2%) et l’environnement et l’entretien des locaux (24%). La conduite à tenir face à des cas suspects, positifs ou contacts a posé question, de même que la pathologie (contagiosité et organisation d’unités dédiées). Enfin, d’autres thèmes ont été abordés comme l’organisation (flux internes, consultations) et les visites des proches. Conclusion. Le CPias Bretagne a été très investi dans ses missions régionales de prévention et de contrôle de l’infection pendant cette crise sanitaire. De nombreux acteurs de la santé avaient besoin d’une adaptation ou d’une interprétation pratique des doctrines nationales, et d’avoir confirmation des conduites à tenir. Localisation OPAC : Montbrison/St-Chamond Support (OPAC) : Article de revue / En ligne (Abo. IFSI) Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MON0000004036 Revues Revue - [m] CDTI Montbrison Revues Disponible Ma perception du risque Covid-19 en centre de dialyse / Agnès GANIER in Hygiènes, 28 (4) (septembre 2020)
Titre : Ma perception du risque Covid-19 en centre de dialyse Type de document : texte imprimé Auteurs : Agnès GANIER, Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : pp. 221-222 Catégories : Accessoire protection ; Dialyse ; Hôpital ; Hygiène hospitalière ; Infirmier ; Infirmier hygiéniste ; Organisation soins ; Pratique professionnelle ; Témoignage ; Travail pluridisciplinaire Résumé : L’année 2020 devait marquer un tournant dans ma carrière d’infirmière, je devais préparer pour le mois de juin mon dossier d’inscription à l’université Jean-Monnet de Saint-Étienne pour préparer le diplôme universitaire (DU) en hygiène hospitalière. En début d’année, très motivée par l’accord de ma direction, j’avais commencé à remplir le dossier. Puis, j’avais mis un peu tout ça de côté pour me consacrer à mes missions d’hygiène au sein de l’association de dialyse où je travaille.C’est alors que le Sars-CoV2 est apparu en France et que nous avons dû revoir nos pratiques et notre fonctionne-ment pour limiter la propagation du virus au sein de notre établissement.Notre principal objectif était que ce virus encore méconnu ne touche pas notre population de patients dialysés très fragiles, mais aussi que le personnel ne soit pas conta-miné. Il fallait répondre à tous en même temps, et c’est là que j’ai compris que mes missions d’hygiène allaient prendre une place particulière.Je devenais un pilier pour le personnel, à la fois pour répondre à ses inquiétudes, et pour mettre en place avec l’infirmière diplômée d’État (IDE) hygiéniste des protocoles sans cesse renouvelés qui s’adaptent au mieux aux différentes situations. Localisation OPAC : Montbrison/St-Chamond Support (OPAC) : Article de revue / En ligne (Abo. IFSI)
in Hygiènes > 28 (4) (septembre 2020) . - pp. 221-222[article] Ma perception du risque Covid-19 en centre de dialyse [texte imprimé] / Agnès GANIER, Auteur . - 2020 . - pp. 221-222.
in Hygiènes > 28 (4) (septembre 2020) . - pp. 221-222
Catégories : Accessoire protection ; Dialyse ; Hôpital ; Hygiène hospitalière ; Infirmier ; Infirmier hygiéniste ; Organisation soins ; Pratique professionnelle ; Témoignage ; Travail pluridisciplinaire Résumé : L’année 2020 devait marquer un tournant dans ma carrière d’infirmière, je devais préparer pour le mois de juin mon dossier d’inscription à l’université Jean-Monnet de Saint-Étienne pour préparer le diplôme universitaire (DU) en hygiène hospitalière. En début d’année, très motivée par l’accord de ma direction, j’avais commencé à remplir le dossier. Puis, j’avais mis un peu tout ça de côté pour me consacrer à mes missions d’hygiène au sein de l’association de dialyse où je travaille.C’est alors que le Sars-CoV2 est apparu en France et que nous avons dû revoir nos pratiques et notre fonctionne-ment pour limiter la propagation du virus au sein de notre établissement.Notre principal objectif était que ce virus encore méconnu ne touche pas notre population de patients dialysés très fragiles, mais aussi que le personnel ne soit pas conta-miné. Il fallait répondre à tous en même temps, et c’est là que j’ai compris que mes missions d’hygiène allaient prendre une place particulière.Je devenais un pilier pour le personnel, à la fois pour répondre à ses inquiétudes, et pour mettre en place avec l’infirmière diplômée d’État (IDE) hygiéniste des protocoles sans cesse renouvelés qui s’adaptent au mieux aux différentes situations. Localisation OPAC : Montbrison/St-Chamond Support (OPAC) : Article de revue / En ligne (Abo. IFSI) Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MON0000004036 Revues Revue - [m] CDTI Montbrison Revues Disponible
Titre : Masque grand public : pourquoi, quand et comment ? Type de document : texte imprimé Auteurs : Joseph Hajjar, Auteur ; Pierre Parneix, Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : pp. 225-230 Catégories : Accessoire protection ; Communication masse ; Contagion ; Epidémie ; Infographie ; Population ; Pouvoirs publics ; Public ; Recommandation ; Santé publique [généralité] ; Utilisation Résumé : En début de pandémie à coronavirus SARS-CoV-2, autorités sanitaires et scientifiques ne recommandaient le port de masque que si l’on était soi-même porteur du virus ou en contact direct avec une personne infectée. La découverte de la part importante de la transmission par des sujets asymptomatiques allait changer la donne en termes de stratégie populationnelle en faisant émerger le concept de masque grand public (masque tissu, barrière ou alternatif) qui permettait aussi de répondre à la pénurie de masques. Après avoir rappelé les critères retenus en termes d’efficacité de filtration et de configuration du masque grand public (et en situant sa place parmi les masques médicaux et appareils de protection respiratoire), sont précisés ses indications, son mode d’emploi et son entretien lorsqu’il est recyclable. Localisation OPAC : Montbrison/St-Chamond Support (OPAC) : Article de revue / En ligne (Abo. IFSI)
in Hygiènes > 28 (4) (septembre 2020) . - pp. 225-230[article] Masque grand public : pourquoi, quand et comment ? [texte imprimé] / Joseph Hajjar, Auteur ; Pierre Parneix, Auteur . - 2020 . - pp. 225-230.
in Hygiènes > 28 (4) (septembre 2020) . - pp. 225-230
Catégories : Accessoire protection ; Communication masse ; Contagion ; Epidémie ; Infographie ; Population ; Pouvoirs publics ; Public ; Recommandation ; Santé publique [généralité] ; Utilisation Résumé : En début de pandémie à coronavirus SARS-CoV-2, autorités sanitaires et scientifiques ne recommandaient le port de masque que si l’on était soi-même porteur du virus ou en contact direct avec une personne infectée. La découverte de la part importante de la transmission par des sujets asymptomatiques allait changer la donne en termes de stratégie populationnelle en faisant émerger le concept de masque grand public (masque tissu, barrière ou alternatif) qui permettait aussi de répondre à la pénurie de masques. Après avoir rappelé les critères retenus en termes d’efficacité de filtration et de configuration du masque grand public (et en situant sa place parmi les masques médicaux et appareils de protection respiratoire), sont précisés ses indications, son mode d’emploi et son entretien lorsqu’il est recyclable. Localisation OPAC : Montbrison/St-Chamond Support (OPAC) : Article de revue / En ligne (Abo. IFSI) Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MON0000004036 Revues Revue - [m] CDTI Montbrison Revues Disponible Prévention des infections nosocomiales à l’hôpital Édouard-Herriot de Lyon / Mélina HOUINSOU HANS in Hygiènes, 28 (4) (septembre 2020)
Titre : Prévention des infections nosocomiales à l’hôpital Édouard-Herriot de Lyon : analyse et utilisation des indicateurs Type de document : texte imprimé Auteurs : Mélina HOUINSOU HANS, Auteur ; Philippe VANHEMS, Auteur ; Élodie MARION, Auteur ; et al. Année de publication : 2020 Article en page(s) : pp. 207-212 Catégories : Clostridium ; Equipe soins ; Hygiène hospitalière ; Indicateur santé [épidémiologie] ; Infection nosocomiale ; Prévention maladie transmissible ; Profession santé ; Qualité soins ; Surveillance épidémiologique Résumé : Introduction. En 2017, 5,2% de la population française hospitalisée a présenté une infection nosocomiale (IN). Les équipes d’hygiène, dénommées localement unités d’hygiène hospitalière et d’épidémiologie (UHE), ont pour mission de surveiller, évaluer et former les professionnels de santé dans le cadre de la prévention des IN. L’objectif de notre travail est d’analyser les indicateurs de fréquence, de processus et de performance dans la lutte contre ces IN en regard des stratégies de prévention et de contrôle mises en place depuis 2010 dans un centre hospitalier universitaire. Méthodologie. L’hôpital Édouard-Herriot, au sein des Hospices civils de Lyon, a été choisi pour mener cette étude. Une analyse des indicateurs de résultats et de processus a été menée pour la période de 2010 à 2017. Les données de surveillance épidémiologique sont complétées par différents rapports issus de formations, audits et réunions afin d’obtenir les indicateurs de processus. Résultats. Le taux d’IN a significativement baissé de 40% de 2010 à 2017 en service de réanimation et de 56,6% dans les suites de transplantations de rein ou de pancréas. On observe cependant une hausse des taux d’infection à Clostridium difficile avec une moyenne annuelle de 0,65 pour 1 000 séjours. Les scores d’indicateurs de processus observés confirment un bon dispositif de prévention, notamment au niveau de l’organisation des services, ainsi qu’une appropriation encourageante, par les équipes soignantes, de l’usage de produit hydro-alcoolique pour la désinfection des mains. Discussion-Conclusion. L’UHE est une structure indispensable dans la lutte contre les IN. Les scores d’indicateurs de processus et les taux d’IN montrent un dispositif efficace en matière de lutte contre les IN, malgré des ressources matérielles faibles. Le contrôle du risque nosocomial repose sur la transmission des bonnes pratiques aux professionnels de santé, mais aussi sur la performance du dispositif de lutte contre les IN dans son ensemble. Localisation OPAC : Montbrison/St-Chamond Support (OPAC) : Article de revue / En ligne (Abo. IFSI)
in Hygiènes > 28 (4) (septembre 2020) . - pp. 207-212[article] Prévention des infections nosocomiales à l’hôpital Édouard-Herriot de Lyon : analyse et utilisation des indicateurs [texte imprimé] / Mélina HOUINSOU HANS, Auteur ; Philippe VANHEMS, Auteur ; Élodie MARION, Auteur ; et al. . - 2020 . - pp. 207-212.
in Hygiènes > 28 (4) (septembre 2020) . - pp. 207-212
Catégories : Clostridium ; Equipe soins ; Hygiène hospitalière ; Indicateur santé [épidémiologie] ; Infection nosocomiale ; Prévention maladie transmissible ; Profession santé ; Qualité soins ; Surveillance épidémiologique Résumé : Introduction. En 2017, 5,2% de la population française hospitalisée a présenté une infection nosocomiale (IN). Les équipes d’hygiène, dénommées localement unités d’hygiène hospitalière et d’épidémiologie (UHE), ont pour mission de surveiller, évaluer et former les professionnels de santé dans le cadre de la prévention des IN. L’objectif de notre travail est d’analyser les indicateurs de fréquence, de processus et de performance dans la lutte contre ces IN en regard des stratégies de prévention et de contrôle mises en place depuis 2010 dans un centre hospitalier universitaire. Méthodologie. L’hôpital Édouard-Herriot, au sein des Hospices civils de Lyon, a été choisi pour mener cette étude. Une analyse des indicateurs de résultats et de processus a été menée pour la période de 2010 à 2017. Les données de surveillance épidémiologique sont complétées par différents rapports issus de formations, audits et réunions afin d’obtenir les indicateurs de processus. Résultats. Le taux d’IN a significativement baissé de 40% de 2010 à 2017 en service de réanimation et de 56,6% dans les suites de transplantations de rein ou de pancréas. On observe cependant une hausse des taux d’infection à Clostridium difficile avec une moyenne annuelle de 0,65 pour 1 000 séjours. Les scores d’indicateurs de processus observés confirment un bon dispositif de prévention, notamment au niveau de l’organisation des services, ainsi qu’une appropriation encourageante, par les équipes soignantes, de l’usage de produit hydro-alcoolique pour la désinfection des mains. Discussion-Conclusion. L’UHE est une structure indispensable dans la lutte contre les IN. Les scores d’indicateurs de processus et les taux d’IN montrent un dispositif efficace en matière de lutte contre les IN, malgré des ressources matérielles faibles. Le contrôle du risque nosocomial repose sur la transmission des bonnes pratiques aux professionnels de santé, mais aussi sur la performance du dispositif de lutte contre les IN dans son ensemble. Localisation OPAC : Montbrison/St-Chamond Support (OPAC) : Article de revue / En ligne (Abo. IFSI) Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MON0000004036 Revues Revue - [m] CDTI Montbrison Revues Disponible Surblouses au centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers / Sandrine JULIENNE in Hygiènes, 28 (4) (septembre 2020)
Titre : Surblouses au centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers Type de document : texte imprimé Auteurs : Sandrine JULIENNE, Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : pp. 223-224 Catégories : Accessoire protection ; Action intérêt collectif ; Infirmier hygiéniste ; Innovation ; Matériel usage unique ; Prise charge ; Risque professionnel ; Sécurité du patient ; Travail pluridisciplinaire Résumé : Cette situation sanitaire inédite a prouvé combien l’être humain pouvait se mobiliser, s’unir, être force de proposition et innover pour la sécurité des patients mais également pour celle des professionnels de santé exposés lors des soins aux patients suspects ou atteints de Covid-19.[...] Localisation OPAC : Montbrison/St-Chamond Support (OPAC) : Article de revue / En ligne (Abo. IFSI)
in Hygiènes > 28 (4) (septembre 2020) . - pp. 223-224[article] Surblouses au centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers [texte imprimé] / Sandrine JULIENNE, Auteur . - 2020 . - pp. 223-224.
in Hygiènes > 28 (4) (septembre 2020) . - pp. 223-224
Catégories : Accessoire protection ; Action intérêt collectif ; Infirmier hygiéniste ; Innovation ; Matériel usage unique ; Prise charge ; Risque professionnel ; Sécurité du patient ; Travail pluridisciplinaire Résumé : Cette situation sanitaire inédite a prouvé combien l’être humain pouvait se mobiliser, s’unir, être force de proposition et innover pour la sécurité des patients mais également pour celle des professionnels de santé exposés lors des soins aux patients suspects ou atteints de Covid-19.[...] Localisation OPAC : Montbrison/St-Chamond Support (OPAC) : Article de revue / En ligne (Abo. IFSI) Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MON0000004036 Revues Revue - [m] CDTI Montbrison Revues Disponible